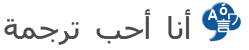- النص
- تاريخ
Biogéographie des ilesLa théorie de
Biogéographie des iles
La théorie de la biogéographie des iles élaborée par MacArthur et Wilson est essentielle pour aborder la biodiversité. Emise en 1967, la théorie "explique" pourquoi certaines iles sont plus peuplées que d'autres. Mais son intérêt va bien au delà. Cette théorie permet aussi de comprendre la structuration d'ecosystèmes continentaux complexes.
La théorie : Soit trois iles. A et B sont à même distance du continent, mais B a une plus grande superficie. C a la même superficie que A, mais est plus éloignée du continent.
La théorie de MacArthur et Wilson dit seulement que le nombre d'espèces sur une ile résulte d'un équilibre entre l'immigration de nouvelles espèces et l'extinction des espèces présentes (la flèche A sur la graphique ci contre montre le point d'équilibre).
Pour des raisons de compétition interspécifique, la probabilité (chance) pour qu'une espèce nouvelle immigre et s'implante sur une ile est inversement proportionnelle au nombre d'espèces présentes (lignes rouges). Pour la même raison, la probabilité pour qu'une espèce installée s'éteigne est proportionnelle au nombre d'espèces présentes (lignes vertes). Une augmentation de la superficie de l'ile réduit la probabilité d'extinction (flèche verte). En conséquence la biodiversité de l'île B est plus grande que celle de l'île A. Un éloignement du continent diminue l'immigration (flèche rouge). La richesse spécifique de l'île C est plus faible que celle de l'île A.
Des situations continentales qui s'apparentent à des iles
L'intérêt de la théorie de MacArthur et Wilson va bien au delà des iles. Elle s'applique à de très nombreuses situations où la fragmentation du milieu (pour des raisons géomorphologiques ou humaines) crée des îles. On parle d "îles continentales". Par exemple
Massifs montagneux
Lacs et bassins fluviaux
Grottes
Réserves biologiques
Massifs forestiers
Péninsules
Intérêt pour l'analyse de la biodiversité des Alpes Maritimes
La théorie de la biogéographie des iles élaborée par MacArthur et Wilson est essentielle pour aborder la biodiversité. Emise en 1967, la théorie "explique" pourquoi certaines iles sont plus peuplées que d'autres. Mais son intérêt va bien au delà. Cette théorie permet aussi de comprendre la structuration d'ecosystèmes continentaux complexes.
La théorie : Soit trois iles. A et B sont à même distance du continent, mais B a une plus grande superficie. C a la même superficie que A, mais est plus éloignée du continent.
La théorie de MacArthur et Wilson dit seulement que le nombre d'espèces sur une ile résulte d'un équilibre entre l'immigration de nouvelles espèces et l'extinction des espèces présentes (la flèche A sur la graphique ci contre montre le point d'équilibre).
Pour des raisons de compétition interspécifique, la probabilité (chance) pour qu'une espèce nouvelle immigre et s'implante sur une ile est inversement proportionnelle au nombre d'espèces présentes (lignes rouges). Pour la même raison, la probabilité pour qu'une espèce installée s'éteigne est proportionnelle au nombre d'espèces présentes (lignes vertes). Une augmentation de la superficie de l'ile réduit la probabilité d'extinction (flèche verte). En conséquence la biodiversité de l'île B est plus grande que celle de l'île A. Un éloignement du continent diminue l'immigration (flèche rouge). La richesse spécifique de l'île C est plus faible que celle de l'île A.
Des situations continentales qui s'apparentent à des iles
L'intérêt de la théorie de MacArthur et Wilson va bien au delà des iles. Elle s'applique à de très nombreuses situations où la fragmentation du milieu (pour des raisons géomorphologiques ou humaines) crée des îles. On parle d "îles continentales". Par exemple
Massifs montagneux
Lacs et bassins fluviaux
Grottes
Réserves biologiques
Massifs forestiers
Péninsules
Intérêt pour l'analyse de la biodiversité des Alpes Maritimes
0/5000
الجغرافيا الحيوية للجزرنظرية الجغرافيا الجزيرة وضعها ماك آرثر و Wilson ضروري لمعالجة التنوع البيولوجي. تنبعث في عام 1967، النظرية "يشرح" لماذا يتم نشر بعض الجزر أكثر من غيرها. ولكن ما يرام اهتمامه في الماضي. هذه النظرية أيضا يساعد على فهم هيكلة النظم الإيكولوجية القارية المعقدة.النظرية: أما الجزر الثلاث. A و B في نفس المسافة من البر الرئيسي، ولكن قد ب مساحة أكبر. ج بنفس المنطقة ألف، ولكن أبعد بعيداً عن القارة.وقال نظرية ماك آرثر و Wilson إلا أن عدد الأنواع في جزيرة هو نتيجة للتوازن بين هجرة أنواع الجديدة، وانقراض الأنواع (يظهر السهم بشأن المخطط ضد نقطة التوازن).من أجل المنافسة احتمال (فرصة) أن هاجر نوعا جديداً، ويوسع على جزيرة تناسبا عكسيا مع عدد من الأنواع (خطوط حمراء). لنفس السبب، احتمال تحول أنواع مثبتة يتناسب مع عدد من الأنواع الحالية (خطوط خضراء). زيادة في منطقة الجزيرة يقلل من احتمال انقراض (السهم الأخضر). ولذلك التنوع البيولوجي ب الجزيرة أكبر من ألف جزيرة بعيداً عن البر الرئيسي الصيني انخفضت الهجرة (السهم الأحمر). ثراء الأنواع ج الجزيرة أقل من ألف جزيرةحالات القارية التي تشبه الجزرمصلحة نظرية ماك آرثر و Wilson تتجاوز الجزر. فإنه ينطبق على العديد من الحالات حيث يقوم بتجزئة للبيئة (لأسباب الجيومورفولوجية أو البشرية) جزر. يتحدث أحد عن د "القاري الجزر". على سبيل المثالسلاسل الجبالأحواض الأنهار والبحيراتالكهوفاحتياطيات البيولوجيةالغاباتشبهالفائدة لتحليل التنوع البيولوجي في Maritimes الب
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


الجغرافيا الحيوية من الجزر
الجزر نظرية الجغرافيا الحيوية وضعت من قبل ماك آرثر ويلسون هو ضروري لمعالجة التنوع البيولوجي. صدر في عام 1967، ونظرية "يشرح" لماذا كانت بعض الجزر المأهولة بالسكان أكثر من غيرها. ولكن اهتمامه تتجاوز. كما يفسر هذه النظرية هيكلة النظم الإيكولوجية القارية المعقدة. نظرية: إما ثلاث جزر. A و B هي نفس المسافة من البر الرئيسى، ولكن B لديها مساحة أكبر. C لديه نفس حجم A، ولكن هو أبعد من القارة. وتقول نظرية ماك آرثر ويلسون فقط أن عدد الأنواع على جزيرة هو نتيجة للتوازن بين الهجرة من الأنواع الجديدة وانقراض الأنواع الحاضر (السهم في يوم يظهر الرسم البياني ضد نقطة التوازن). للمنافسة الأسباب بين الأنواع احتمال (الحظ) ليهاجر أنواع جديدة ويزرع نفسه على جزيرة يتناسب عكسيا مع عدد من "الأنواع (الخطوط الحمراء). لنفس السبب، واحتمال أن يتم تثبيت نوع من يتناسب مع عدد من الأنواع الحالية (خطوط خضراء). زيادة في منطقة الجزيرة قللت من احتمال انقراض (السهم الأخضر). ونتيجة لذلك التنوع الحيوي في جزيرة B هو أكبر من ألف جزيرة على مسافة من البر الرئيسى يقلل الهجرة (السهم الأحمر). ثراء الأنواع من الجزيرة C هو أقل من جزيرة ألف الأوضاع القارية التي تشبه الجزر مصلحة نظرية ماك آرثر ويلسون يذهب إلى أبعد من الجزر. وهو ينطبق على عدد كبير جدا من الحالات التي تجزئة الموائل (لأسباب الجيومورفولوجية أو الإنسان) يخلق الجزر. نحن نتحدث عن "الجزر القارية". على سبيل المثال تتراوح جبل البحيرات وأحواض الأنهار كهوف البيولوجية احتياطيات كتل صخريه الغابات شبه جزيرة الفائدة في تحليل التنوع البيولوجي في ماريتيم ألب
الجزر نظرية الجغرافيا الحيوية وضعت من قبل ماك آرثر ويلسون هو ضروري لمعالجة التنوع البيولوجي. صدر في عام 1967، ونظرية "يشرح" لماذا كانت بعض الجزر المأهولة بالسكان أكثر من غيرها. ولكن اهتمامه تتجاوز. كما يفسر هذه النظرية هيكلة النظم الإيكولوجية القارية المعقدة. نظرية: إما ثلاث جزر. A و B هي نفس المسافة من البر الرئيسى، ولكن B لديها مساحة أكبر. C لديه نفس حجم A، ولكن هو أبعد من القارة. وتقول نظرية ماك آرثر ويلسون فقط أن عدد الأنواع على جزيرة هو نتيجة للتوازن بين الهجرة من الأنواع الجديدة وانقراض الأنواع الحاضر (السهم في يوم يظهر الرسم البياني ضد نقطة التوازن). للمنافسة الأسباب بين الأنواع احتمال (الحظ) ليهاجر أنواع جديدة ويزرع نفسه على جزيرة يتناسب عكسيا مع عدد من "الأنواع (الخطوط الحمراء). لنفس السبب، واحتمال أن يتم تثبيت نوع من يتناسب مع عدد من الأنواع الحالية (خطوط خضراء). زيادة في منطقة الجزيرة قللت من احتمال انقراض (السهم الأخضر). ونتيجة لذلك التنوع الحيوي في جزيرة B هو أكبر من ألف جزيرة على مسافة من البر الرئيسى يقلل الهجرة (السهم الأحمر). ثراء الأنواع من الجزيرة C هو أقل من جزيرة ألف الأوضاع القارية التي تشبه الجزر مصلحة نظرية ماك آرثر ويلسون يذهب إلى أبعد من الجزر. وهو ينطبق على عدد كبير جدا من الحالات التي تجزئة الموائل (لأسباب الجيومورفولوجية أو الإنسان) يخلق الجزر. نحن نتحدث عن "الجزر القارية". على سبيل المثال تتراوح جبل البحيرات وأحواض الأنهار كهوف البيولوجية احتياطيات كتل صخريه الغابات شبه جزيرة الفائدة في تحليل التنوع البيولوجي في ماريتيم ألب
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- Fıstıklı çikolata mı, çikolatalı fıstık
- مضارع last
- الله لا يفرقنا
- انا وانتى
- مرحبا
- وانت ايضا
- بشرة خير أيها الإنسان هل استيقظت على هدي
- Bol kremalı, çikolatalı bir kek hazırlam
- ممكن اتعرف
- muy lindos los detalles
- اين انتي
- demek Seni seviyorum
- We're missing some details from you belo
- demek seviyorum
- اسمك اية
- الاطفال يعبرون عن البراءة الخالصة
- Mandame una foto
- Kahve keyfinize sevgimizi katıyoruz!
- Find the oppites of the underlined words
- seviyorum
- بايخه
- Cine ?
- Reach top3 on the leaderboard
- Fıstıklı çikolata mı, çikolatalı fıstık